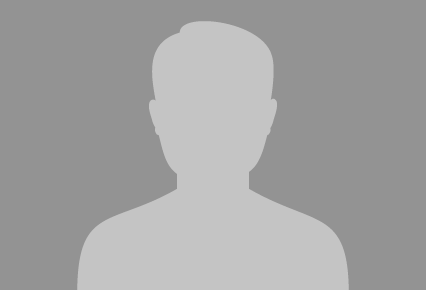« Maman dit que je suis spécial » est une phrase souvent lancée sur le ton de la plaisanterie. Mais pour ceux qui intègrent les forces spéciales, le mot « spécial » prend une tout autre dimension. Ces opérateurs ne sont pas définis par leur titre – ils constituent l'épine dorsale des forces militaires d'élite, prêtes à affronter l'impossible. Ils sont les seuls à être vraiment spéciaux, entraînés à exécuter des missions à haut risque et à fort enjeu dans les conditions les plus extrêmes. Dans ce billet, Jürgen Hatzenbichler, journaliste à Vienne (Autriche) et directeur de la publication de spartanat.com, plonge dans l'univers unique des forces spéciales. Fort d'une formation en philosophie et en histoire, Jürgen analyse l'entraînement, l'équipement, l'état d'esprit et le dévouement qui caractérisent ces unités d'élite. Des missions à haut risque à l'incessante volonté de se perfectionner, cet article met en lumière les éléments essentiels qui distinguent les forces spéciales sur le champ de bataille en perpétuelle effervescence d'aujourd'hui.
In this blog post:
- Le monde unique des forces spéciales
- Les forces spéciales n'entrent pas dans les normes militaires - et c'est ce qui fait leur force
- Dans le monde des troupes d'élite : Du GSG 9 aux forces spéciales ukrainiennes
- Une culture d'opérateurs
- La formation des opérateurs des forces spéciales : Un monde d'extrêmes
- Forces spéciales : L'outil ultime à haute valeur ajoutée
- Le large spectre des missions des forces spéciales
- Conclusion : Qui ose gagne
Auteur: Jürgen Hatzenbichler
Le monde unique des forces spéciales
Alex a servi au sein du Kommando Spezialkräfte (KSK) de la Bundeswehr, les forces spéciales d'élite allemandes. Officier chevronné de la première heure, il est toujours actif aujourd'hui. Lorsque nous lui demandons ce que sont les forces spéciales, sa réponse est sans détour :
“Des combattants hautement entraînés, compétents et résistants, chargés de missions et de tâches exceptionnellement spécialisées.”
Ulrich, lui, vient du monde des forces spéciales de la police, plus précisément du Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9). Pour lui, les forces spéciales sont
“Des unités tactiques capables de faire face à des situations complexes et périlleuses, de lutter contre le terrorisme, le crime organisé et de mener des opérations qui dépasseraient les capacités d'un policier ordinaire”.
Gustav propose une explication plus large. Ancien sergent du génie allemand, aujourd'hui engagé dans les forces spéciales ukrainiennes, Gustav a vu de ses propres yeux les réalités brutales de la guerre.
« Les forces spéciales sont des unités chargées de missions uniques que les forces régulières ne peuvent pas exécuter, ou elles s'attaquent à des missions régulières en utilisant des méthodes non conventionnelles. Ces unités sont spécifiquement entraînées pour ces rôles ».
« Faire partie d'une unité de forces spéciales ne signifie pas que l'on est meilleur que les autres », ajoute Gustav. « Cela signifie que vous avez choisi une voie qui exige de vous des choses différentes - parfois plus, parfois simplement différentes. Ce qui nous rend 'spéciaux', ce n'est pas un privilège ; c'est l'obligation d'être performant lorsque l'échec n'est pas une option ».
Ce sentiment se retrouve dans tous les rangs. Ulrich, du GSG 9, explique :
« Notre travail n'est pas axé sur la célébrité. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, souvent sans reconnaissance. Dès que vous vous considérez comme supérieur, vous n'êtes plus apte à effectuer ce travail ».

Les forces spéciales n'entrent pas dans les normes militaires - et c'est ce qui fait leur force
Pour Nemo, officier de la marine allemande et nageur de combat, le concept même de forces spéciales semble en contradiction avec les structures militaires conventionnelles. « L'armée, c'est la structure, l'égalité, la tentative de mettre de l'ordre dans le chaos de la guerre », explique-t-il. « Même les missions de base sans combat direct nécessitent des procédures complexes et un ordre constant. En revanche, les forces spéciales opèrent en dehors de ces limites, s'appuyant sur l'adaptabilité, la créativité et la pensée asymétrique.
Il cite la guerre d'Indépendance américaine comme premier exemple de la façon dont les formations rigides ont dominé la stratégie traditionnelle, tandis que des tactiques plus agiles et non conventionnelles ont progressivement gagné du terrain. Les forces spéciales modernes telles que nous les connaissons sont apparues bien plus tard. Des unités pionnières comme le Special Air Service (SAS) et le Special Boat Service (SBS) britanniques ont jeté les bases des opérations spéciales d'aujourd'hui, démontrant l'impact de la guerre non orthodoxe et influençant la doctrine militaire au plus haut niveau. Des leaders tels que Roger Courtney et David Stirling ont prouvé que pour réussir dans des environnements imprévisibles, il fallait des opérateurs qui ne se contentaient pas de suivre les ordres, mais qui pensaient au-delà.
« Nous ne sommes pas là pour répéter ce qui a été fait, nous sommes là pour nous adapter », déclare Nemo. « La tradition des nageurs de combat prospère parce que nous avons toujours regardé vers le monde, vers le Commando Hubert en France, vers les U.S. SEALs, vers tous ceux dont nous pouvons apprendre quelque chose. C'est ainsi que nous restons efficaces.
Dans le monde des troupes d'élite : Du GSG 9 aux forces spéciales ukrainiennes
Les forces spéciales allemandes opèrent depuis longtemps dans l'ombre : élitisme, discipline et entraînement pour des missions qui font rarement la une des journaux. Au fil des décennies, ces unités ont non seulement façonné les capacités de l'Allemagne en matière de lutte contre le terrorisme et de réaction rapide, mais elles ont également suscité l'admiration et l'émulation à l'étranger. Aujourd'hui, leur influence s'étend au-delà des frontières et résonne dans des endroits comme l'Ukraine, où la guerre moderne exige à la fois tradition et innovation.
La voie allemande vers les opérations spéciales modernes
L'évolution de l'Allemagne en matière d'opérations spéciales a commencé avec sa plus ancienne unité de forces spéciales : les nageurs de combat de la marine allemande, fondée en 1959. Conçue pour opérer sur terre et en mer, cette unité incarnait le même esprit anticonformiste qui définit les forces spéciales dans le monde entier. Une étape décisive a été franchie lorsque l'unité a adopté des capacités aéroportées - le saut en parachute dans l'eau - en s'inspirant des méthodes utilisées par le « Commando Hubert », une unité d'élite française. Cette innovation a contribué à la formation des forces d'opérations spéciales (SOF) modernes de l'Allemagne.
Le 1er avril 1964, les nageurs de combat ont été réorganisés en une unité indépendante, le groupe amphibie de la marine allemande. Dans les années 1970, ils ont établi leur base à Eckernförde. À partir de 1975, un programme d'échange novateur avec les SEALs de la marine américaine a permis aux deux unités de partager leurs tactiques, leur équipement et leurs connaissances opérationnelles. Cette collaboration a non seulement permis d'accroître les capacités des forces spéciales allemandes, mais elle a également renforcé une vérité fondamentale : les opérations spéciales réussissent en embrassant la différence, et non la conformité.
La genèse et l'héritage du GSG 9
À la suite des événements tragiques survenus aux Jeux olympiques de Munich en 1972, où neuf athlètes israéliens ont été tués lors d'une tentative de sauvetage ratée, l'Allemagne a reconnu le besoin urgent d'une unité spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Le lieutenant-colonel Ulrich Wegener, alors officier de liaison au ministère fédéral allemand de l'Intérieur, est chargé de mettre sur pied cette force. En avril 1973, le GSG 9 est opérationnel et ses capacités sont rapidement mises à l'épreuve.
L'unité a connu son heure de gloire en octobre 1977, lors du détournement du vol 181 de la Lufthansa, connu sous le nom d'incident de « Landshut ». Quatre militants palestiniens s'étaient emparés de l'avion pour réclamer la libération de membres de la Fraction Armée Rouge emprisonnés. Après une période éprouvante de cinq jours, les commandos du GSG 9 ont pris l'avion d'assaut à Mogadiscio, en Somalie, et ont réussi à sauver les 91 otages sans qu'il y ait de morts parmi les passagers ou l'équipe de sauvetage. Cette opération a non seulement démontré l'efficacité du GSG 9, mais a également renforcé la réputation de Wegener, qui a été surnommé le « héros de Mogadiscio ».
En réfléchissant à ce qui définit un opérateur du GSG 9, Wegener a souligné l'importance de l'engagement : « La volonté d'être un opérateur et de vouloir le vivre... de relever des défis chaque jour et d'être prêt et capable de dépasser ses limites mentales et physiques. Pour lui, être opérateur n'est pas seulement un rôle, mais une vocation personnelle, qui exige des individus qu'ils adaptent entièrement leur vie aux exigences de l'unité.
ABONNE-TOI POUR ACCÉDER À NOTRE CONTENU EXCLUSIF
Saisissez votre adresse électronique et recevez des mises à jour opportunes et des informations pertinentes sur des sujets tactiques directement dans votre boîte de réception.
Vous vous inscrivez pour recevoir des mises à jour par e-mail, dont vous pouvez vous désabonner à tout moment. Lisez notre politique de confidentialité.
La double nature des forces spéciales : Rôles policier et militaire
Le GSG 9 allemand est un excellent exemple de la façon dont les forces spéciales peuvent être à cheval entre les domaines policier et militaire. Créé après la prise d'otages des Jeux olympiques de Munich en 1972, le GSG 9 faisait initialement partie des gardes-frontières (BGS) et est devenu depuis une unité d'élite de lutte contre le terrorisme au sein de la police fédérale. Ulrich, membre du GSG 9, explique : « Les unités de police ont toujours eu une structure militaire. La distinction entre les forces de police et les forces spéciales militaires n'est pas aussi nette que beaucoup le pensent ».
Alors que l'armée se concentre sur le combat, les forces spéciales de la police, comme le GSG 9, sont chargées de lutter contre les menaces civiles. Leurs responsabilités comprennent la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages et le travail de police spécialisé, ce qui montre que les forces spéciales peuvent passer sans problème d'un rôle militaire à un rôle de maintien de l'ordre, selon les besoins.
« Les environnements civils requièrent un ensemble de compétences différent », explique Ulrich. « Vous opérez au milieu de vos propres concitoyens. Le risque de dommages collatéraux est plus élevé. C'est là que la formation se confond avec l'empathie : vous devez rester précis et modéré, même sous la pression ».

L'évolution des forces spéciales allemandes : Le KSK
Deux décennies plus tard, l'intérêt de l'Allemagne pour les capacités d'élite s'est étendu de la lutte contre le terrorisme aux déploiements militaires mondiaux. La création du Kommando Spezialkräfte (KSK) en 1996 a marqué l'engagement de l'Allemagne à développer une unité militaire de réaction rapide capable de mener à bien des missions internationales complexes. La formation du KSK a été largement motivée par les défis logistiques et opérationnels rencontrés lors de la crise du Rwanda, où l'Allemagne n'avait pas la capacité d'évacuer efficacement ses propres citoyens.
La KSK s'est inspirée en partie du SAS britannique et a attiré dès le début des personnes ayant une expérience du combat et une vision tactique. Comme l'a fait remarquer l'un des premiers membres, Alex : « Pourquoi réinventer la roue alors que certains font déjà un excellent travail ?
La mission du KSK comprend la reconnaissance, la surveillance et le sauvetage des citoyens allemands dans les zones de crise. Au fil du temps, son rôle s'est élargi pour inclure un large éventail d'opérations de guerre non conventionnelle et d'opérations à haut risque. Cependant, l'unité a également fait l'objet d'un examen interne, parfois critiqué pour sa culture élitiste et sa dérive idéologique. En réponse, des réformes ont été mises en œuvre pour renforcer le contrôle et les valeurs démocratiques au sein de la force.
Les forces spéciales ukrainiennes : Un mélange de traditions et d'innovations
L'esprit d'adaptation n'a jamais été aussi évident qu'en Ukraine, où le conflit a forgé une nouvelle génération de forces spéciales. Parmi ses membres, Gustav, un ancien sous-officier de l'armée allemande qui a rejoint la Légion internationale ukrainienne. « On trouve ici toutes sortes d'expériences », explique-t-il. « Certains se sont entraînés avec le MARSOC, d'autres avec les forces finlandaises ou baltes. C'est un mélange, mais ça marche.
Les forces spéciales ukrainiennes opèrent avec un mélange éclectique de doctrines, s'inspirant des pays alignés sur l'OTAN tout en répondant à des défis locaux distincts. La guerre des drones, par exemple, est devenue un élément central des opérations. Le terme « opérateur de drone » désigne désormais souvent les pilotes d'UAV - une évolution du terme qui reflète le champ de bataille d'aujourd'hui.
Il est intéressant de noter qu'en Ukraine, le terme « opérateur » est parfois réservé aux personnes issues des forces spéciales occidentales, ce qui lui confère une sorte de prestige informel. Mais la guerre a démocratisé cette identité : c'est l'expérience en première ligne, et non le pedigree, qui définit votre valeur.
À mesure que la guerre progresse, les forces spéciales ukrainiennes ressemblent de plus en plus à l'avenir de la guerre asymétrique : elles sont allégées, dotées de technologies et fortement décentralisées. Leur capacité d'adaptation met en évidence une leçon plus large pour toutes les unités spéciales : les temps de paix ne sont pas une excuse pour se reposer sur ses lauriers. La préparation ne s'arrête jamais.
Repenser l'avenir
Les forces spéciales allemandes, qu'il s'agisse du GSG 9, du KSK ou de leurs homologues en Ukraine, sont confrontées à un monde qui ne suit plus les règles conventionnelles. La surveillance, les drones, les moyens cybernétiques et l'IA réécrivent les règles du jeu opérationnel. Les unités d'élite d'aujourd'hui doivent s'entraîner non seulement plus durement, mais aussi plus intelligemment, et être prêtes à s'adapter à la volée.
Mais à travers tous ces changements, une chose reste constante : l'essence même de ce que signifie être un soldat. Ce n'est pas l'uniforme, l'écusson ou la mission qui compte, c'est l'état d'esprit. Qu'il s'agisse de prendre d'assaut un avion détourné en Somalie ou de piloter un drone de reconnaissance au-dessus de l'est de l'Ukraine, c'est cet état d'esprit qui continue de définir les forces d'élite du monde entier.
Une culture d'opérateurs
Qu'est-ce qui rend quelqu'un apte à faire partie des forces spéciales ? Nous avons posé la question à Nemo, un officier nageur de combat, qui a longuement réfléchi avant de répondre : « Il faut des individus qui, de leur plein gré et volontairement - car la plongée dans la marine allemande est toujours volontaire - sont très motivés, avec un fort désir de servir. » Il poursuit : « Il faut des personnes au caractère bien trempé et aptes à résoudre les problèmes. Ils doivent être capables de s'adapter et d'exceller dans leurs compétences de base, car ces personnes sont 'brillantes dans les bases'. Cela leur permet d'être efficaces à la fois dans des rôles de leadership et dans des rôles au sein d'une équipe ».
Les vétérans décrivent souvent un état d'esprit plus qu'un ensemble de compétences.
« Être opérateur, ce n'est pas un travail “, explique Alex, ” c'est un mode de vie. « C'est un mode de vie. On s'entraîne, on mange et on se repose avec une mission en tête. La frontière entre le personnel et le professionnel disparaît.
Cet état d'esprit reflète la philosophie antérieure de Wegener. Le GSG 9 et le KSK exigent plus que l'excellence physique : ils requièrent une résistance psychologique et la capacité d'opérer de manière indépendante, souvent avec des informations incomplètes et sous une pression extrême.
Pour être réellement préparé aux opérations des forces spéciales, il faut développer non seulement l'endurance physique, mais aussi l'état d'esprit adéquat. Nous approfondissons cette question dans notre article de blog intitulé L'état d'esprit des forces spéciales : Se préparer pour le test ultime, qui explique comment le conditionnement mental est aussi important que l'entraînement physique lors de la préparation de missions d'élite.

La formation des opérateurs des forces spéciales : Un monde d'extrêmes
Les opérateurs des forces spéciales sont entraînés à travailler dans les conditions les plus difficiles que l'on puisse imaginer, tant sur le plan physique que mental. Leur entraînement couvre toute la gamme des environnements : Le froid arctique atteint -30°C, la chaleur du désert grimpe à plus de +40°C et l'humidité de la jungle dépasse les 90 %. On attend des opérateurs qu'ils soient performants dans tous ces environnements. L'endurance est essentielle : courir 5 000 mètres en moins de 20 minutes, nager sur des distances allant jusqu'à 30 kilomètres et porter des charges de plus de 60 kilogrammes est souvent la norme, et non l'exception.
Les unités d'élite suivent également un entraînement aéroporté avancé. Des techniques telles que HALO (High Altitude, Low Opening) et HAHO (High Altitude, High Opening) exigent non seulement du courage, mais aussi une précision et une endurance incroyables. Dans la technique HALO, les opérateurs sautent d'une altitude supérieure à 10 000 pieds et ouvrent leur parachute près du sol afin de minimiser la détection, ce qui est essentiel pour les opérations furtives derrière les lignes ennemies. Le HAHO, quant à lui, consiste à ouvrir le parachute peu après le saut, ce qui permet aux opérateurs de planer silencieusement sur de longues distances. Les deux méthodes nécessitent une acclimatation à la haute altitude et une maîtrise exceptionnelle sous pression.
Pour en savoir plus sur la façon dont l'entraînement moderne prépare ces soldats à de tels extrêmes, consultez notre article de blog : Comment les Forces d’Opérations Spéciales Gardent une Longueur d'Avance dans le Combat.
Mais la condition physique n'est qu'une face de la médaille. La résistance mentale est tout aussi essentielle. Les opérateurs des forces spéciales sont entraînés à agir dans des conditions de stress extrêmes : ils dégainent une arme et tirent en moins d'une seconde, distinguent instantanément l'ami de l'ennemi et exécutent des tâches complexes avec peu de sommeil ou d'oxygène, parfois pendant des jours. La capacité à rester calme sous le feu, à traiter rapidement les informations et à prendre des décisions de vie ou de mort en un clin d'œil sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent.
Ce niveau de préparation n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se développe au cours d'un processus de sélection et de préparation éprouvant, que nous examinons plus en détail dans nos articles de blog : Naviguer dans le processus de sélection des forces spéciales avec d'anciens membres.

Les missions réelles donnent un aperçu de ce à quoi cet entraînement les prépare. Un exemple bien connu est l'opération de la Team 6 des Navy SEAL qui a conduit à l'élimination d'Oussama ben Laden. Cette mission a nécessité des capacités de pénétration HALO, de la furtivité, une prise de décision en une fraction de seconde et de la précision sous pression. Un autre exemple est le raid d'Entebbe, au cours duquel les forces spéciales israéliennes ont sauvé des otages en Ouganda, mettant en évidence le type de planification rapide et l'exécution sans faille qui caractérise ces unités d'élite. Gustav se souvient :
« En Ukraine, nous nous entraînions chaque jour à agir comme si c'était la dernière fois. Ce n'est pas hypothétique. Lorsque vous êtes sous le feu de l'artillerie, votre préparation physique et mentale est soit suffisante, soit fatale. Il n'y a pas de juste milieu. »
Ulrich ajoute : « Dans les scénarios de prise d'otages, il n'y a pas de seconde chance. Nous nous entraînons pour atteindre la perfection, non pas parce que c'est réalisable, mais parce que tout ce qui n'est pas parfait peut entraîner la perte de vies humaines. »
Ces histoires - et l'entraînement qui les sous-tend - montrent pourquoi les forces spéciales comptent parmi les professionnels les plus compétents, les plus fiables et les plus résistants des opérations militaires modernes.
Forces spéciales : L'outil ultime à haute valeur ajoutée
En définitive, chaque opérateur est un « outil » au service de la sécurité nationale et déployé en fer de lance. Il prend des décisions en une fraction de seconde qui ont des conséquences significatives. Leur entraînement, qui peut coûter plus de 1,5 million d'euros par individu, leur permet d'être « prêts au combat » après trois ans de préparation intense. Les forces spéciales sont donc plus que des soldats d'élite, ce sont des instruments stratégiques à la disposition des autorités militaires et politiques.
Lorsqu'il s'agit de passer à l'action, les forces spéciales excellent au sein d'équipes réduites, opérant sous une pression extrême. Comme l'explique Alex du KSK, « Nous sommes des Olympiens mais nous n'existerions pas sans un solide système de soutien. Comme des athlètes soutenus par une fédération de professionnels et d'amateurs. » Les forces spéciales ne sont peut-être pas « meilleures » que les unités régulières, mais elles se trouvent au sommet de la pyramide et constituent souvent l'élite d'une organisation plus vaste.
« En fin de compte, dit Nemo, nous ne sommes qu'un élément d'une machine beaucoup plus grande. Sans la logistique, le renseignement et des unités conventionnelles qui tiennent la route, nos missions ne seraient pas possibles. Nous comptons sur eux autant qu'ils comptent parfois sur nous ».

Le large spectre des missions des forces spéciales
Les forces spéciales sont entraînées à être polyvalentes et à jouer différents rôles, souvent dans des situations où les forces traditionnelles ne peuvent intervenir. Leurs capacités couvrent un large éventail d'opérations critiques :
- Action directe : Opérations offensives qui permettent d'amener la force à l'ennemi.
- Reconnaissance spéciale : Collecte de renseignements en vue d'opérations stratégiques.
- Assistance militaire : Formation et soutien d'unités militaires étrangères.
- Protection rapprochée : Offrir une sécurité personnelle à des personnes très en vue.
- Sauvetage et récupération d'otages : Sauvetage d'otages en toute sécurité dans des environnements dangereux.
- Lutte contre le terrorisme : Neutraliser les menaces terroristes avant qu'elles ne dégénèrent.
- Guerre non conventionnelle : Engagement dans une guérilla ou soutien aux insurgés.
- Opérations secrètes : Exécuter des missions discrètement et dans le secret.
Gustav note : « Sur le terrain en Ukraine, les limites sont floues. Un jour, il s'agit de faire de la reconnaissance derrière les lignes ennemies ; le lendemain, il s'agit de coordonner les forces locales en vue d'un sabotage. La flexibilité est la marque de fabrique des unités de FS efficaces aujourd'hui ».

Conclusion : Qui ose gagne
Les forces spéciales ne ressemblent en rien aux unités militaires traditionnelles. Leurs compétences uniques et leur entraînement d'élite en font des outils inestimables pour mener à bien des opérations critiques. Comme le dit la devise des SAS britanniques, « Qui ose gagne ». Les forces spéciales se chargent des missions les plus dangereuses et les plus vitales, souvent dans le plus grand secret. Ce sont des individus qui sont toujours prêts lorsque d'autres ne le sont pas, capables d'agir là où les unités régulières ne le peuvent pas. Leur travail est éreintant, souvent classifié, et toujours en première ligne de la sécurité nationale.
Les forces spéciales ne sont pas formées uniquement dans des camps d'entraînement ou sur des champs de bataille lointains - elles sont façonnées par une philosophie qui transcende l'uniforme et le grade. Il s'agit de précision, d'humilité et de résilience face à l'imprévisible. Comme le dit Nemo, « servir dans les forces spéciales, c'est faire la paix avec le chaos, puis trouver un moyen de gagner en son sein ».